
Illustrations: Anne DAYOT
L’empathie est duale, émotionnelle et cognitive. La première est plus spontanée, ouvrant à l’identification et la résonance avec l’autre. La deuxième est plus intellectuelle et délibérative, faisant appel à un travail de nos fonctions exécutives. Alliant ainsi l’intersubjectivité à la théorie de l’esprit, elle intervient comme un moyen de présence et de connaissance d’autrui, un moyen d’Etre avec le patient, en restant Je, pour bien garder le contrôle du chemin thérapeutique.
Ces descriptions étant posées , envisageons maintenant la place de l’empathie dans notre quotidien, notamment face aux menaces qu’elle rencontre, le risque de manipulation et la polémique avec la compassion.
RISQUE DE L’EMPATHIE ÉMOTIONNELLE
Par effet de mode qui détrône la résilience, notre société en vient à galvauder l’empathie. Ce mot présente certes un attrait séduisant par sa référence à un optimisme relationnel, dans un monde de paradoxe où le vivre ensemble n’est plus une priorité. Sans doute par crainte de l’avenir dans sa relation au présent difficile, l’homme se met en fragilité, en s’isolant de tout ce qui n’est pas sûr, non semblable à lui-même.
Cet état de vulnérabilité, apanage de toutes les périodes de crises, donne pouvoir à la manipulation de l’empathie qui vient se poser en apparence comme un label de bienfaisance, d’une action de fait louable, alors qu’elle ne dessert que les intérêts de l’émetteur, parfois pour le pire. L’énumération est sans limite, que ce soit dans le domaine publicitaire, politique, commercial, voire à l’extrême par des régimes totalitaires jusqu’au terrorisme. Si l’empathie cognitive est un outil pour conduire notre travail face au patient, d’autres moins bien intentionnés sont tout aussi à même de l’exploiter à des fins moins louables sur autrui, usant de sa vulnérabilité d’empathie émotionnelle.
Nous verrons un peu plus loin que c’est même une arme pour les pourfendeurs de l’empathie. Au-delà d’avoir la velléité de vouloir sauver le monde de ces impostures, le thérapeute qui a en face de lui un patient fragilisé doit se garantir que son exercice est bien adapté, et conforme à la demande ou aux besoins exprimés ; pas plus, pas moins.
DE L’EMPATHIE À LA COMPASSION
Abordons maintenant la compassion qui vient atteindre notre empathie jusque dans son identité. Pour certains en effet, cette dernière doit être mise au rebut, car elle conduit inévitablement le porteur d’empathie à un burn-out ; et cela en raison d’un risque de contagion émotionnelle majeure. Matthieu Ricard, dans son livre Plaidoyer pour l’altruisme, affirme qu’il est nécessaire d’imprégner l’empathie de compassion, voire la substituer, précisément pour les soignants, afin de leur permettre de garder une distance en termes d’émotions. Cette compassion empêche que la résonance affective dans son amplification ne vienne paralyser le soignant et engendrer un épuisement émotionnel conduisant à un burn-out inévitable. Remplie d’amour altruiste, la compassion est pour lui le seul antidote possible.
Nous reviendrons plus loin sur sa conception du burn-out un peu réductrice. Mais de façon étonnante, Matthieu Ricard, comme d’autres, réduit l’empathie à l’empathie affective (ou émotionnelle) à laquelle il oppose la compassion qui, elle seule, se situe dans une démarche rigoureusement active. Pour appuyer sa théorie, il s’associe à la psychologue Tania Singer, directrice de l’Institut des neurosciences sociales Max Planck à Leipzig, qui prétend qu’on ne peut utiliser les mêmes termes d’empathie pour une partie affective et cognitive, car elle concerne deux zones différentes du cerveau. Ces théories sont reprises par d’autres neuroscientifiques et psychologues des USA à la Suisse.
Se reposant sur les menaces que nous venons d’aborder, le psychologue Paul Bloom (université de Yale), dans son livre Against Empathy : The Case for Rational Compassion en 2016, affirme son opposition à l’empathie qu’il qualifie de « ressenti comme », et qui conduit à prendre de mauvaises décisions, pouvant même nous entraîner dans des formes de cruauté. Pour étayer ses dires, il cite de nombreux exemples, où la barbarie s’invente des bonnes raisons, notamment l’Allemagne des années 1930 avec les attaques antisémites, et plus actuellement le président des USA qui par des manœuvres d’empathie à l’égard de la classe moyenne « qu’il comprend », a largement activé l’hostilité contre les réfugiés, offrant des récits des « pauvres victimes » qui en ont subi les actions. Sans prendre la peine de séparer le bon du mauvais, et en jetant tout de l’empathie, Paul Bloom ajoute que l’avantage de la compassion est qu’elle n’a pas besoin d’éprouver la souffrance de l’autre puisqu’elle est dans l’action. Pour lui, comme pour beaucoup, elle seule est dans le « care ». Il ne s’adresse donc pas aux soignants, qui eux, sont déjà dans le « care » !
Comment sortir de cette opposition que Serge Tisseron résume très bien ainsi : d’un côté, ceux qui prônent la compassion comme la transformation de l’empathie sous forme d’action, devenant ainsi un mode de prévention du burn-out. De l’autre, le psychologue Charles Figley, directeur de l’université de Tulane en Louisiane et spécialiste du trauma, affirme que la compassion mène au burn-out et que seule l’empathie cognitive peut l’éviter.
COMPASSION ET CULTURE
Au-delà de servir une querelle de clochers probable, il existe une différence sémantique entre les termes « empathie » et « compassion ». Notons qu’il existe également plusieurs connotations du terme compassion.
Dans la tradition chrétienne, le mot compassion signifie « souffrir avec... », la passion évoquant la souffrance, en référence à la passion du Christ. Dans la tradition bouddhiste, le mot empathie n’existe pas, et le mot compassion a une tout autre signification. Il est important d’aborder cette question de la signification de la compassion dans le bouddhisme puisque la majorité des détracteurs de l’empathie ont un discours d’inspiration bouddhiste, souvent en rapport à une pratique associée.
Pour saisir le sens de leur argumentaire, il faut acquérir quelques connaissances sur cette tradition. Le bouddhisme, qui est aussi une philosophie de vie, allie le respect, la compassion, la pensée de l’autre, mais plus encore au travers des Quatre nobles vérités, prône l’inévitabilité de la souffrance et le chemin d’éveil pour en sortir. La compassion, constituant de ce chemin, est une « claire » acceptation des autres comme de soi-même, avec cette capacité d’être avec l’autre, dans son bonheur et son chagrin, avec amour et partage. La « clarté », par opposition à la confusion génératrice de nombre de maux, est acquise au décours de la pratique de la méditation bouddhiste. Finalement la compassion est à la tradition bouddhiste ce qu’est la miséricorde aux traditions abrahamiques (« une vertu du cœur compatissant qui partage la misère d’autrui afin de la secourir »).
Dans toutes ces traditions spirituelles, la compassion trouve sa véritable expression sur le précepte de ne pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fasse ; elle se positionne dans une connivence entre une instance supérieure et les hommes qui en dépendent. De même dans la culture africaine, l’« Ubuntu », issu de la culture bantou, valorise aussi la compassion, associée au « vivre ensemble », à l’interdépendance des individus dans la communauté et à la dignité de chacun. Il importe de comprendre que les discours et les traditions différentes trouvent leur unité dans ce que Régis Debray appelait si bien « la laïcité de la connaissance ». Faut-il rejeter la compassion en raison de sa référence bouddhiste ? Certainement pas ! Rappelons que la « mindfulness », par sa laïcisation de la méditation bouddhiste, a été un apport considérable dans les TCC de troisième vague basées sur les émotions (3). Cette pratique laïque continue son œuvre dans la gestion des émotions : un effet thérapeutique indéniable et validé s cientifiquement, un apport pour le thérapeute, quelle que soit sa pratique.
APPROCHE CLINIQUE
Dès 2020, nous avons organisé des groupes de prévention du burn-out dans un service d’urgence, particulièrement contraignant en termes de pénibilité, en associant la mindfulness et l’hypnose, ainsi que les théories de Paul Watzlawick sur la communication humaine, tout en abordant les démarches d’empathie émotionnelle et cognitive. Ces dernières amènent ces soignants à beaucoup plus de distance face au stress perçu et transmis par les patients. La poursuite de notre travail avec des groupes MBI (Mindfulness Based Intervention) au profit de soignants d’autres services, s’est avérée très porteuse en termes de gestion émotionnelle.
Après un travail longitudinal de deux années sur la prise en charge du burn-out par le MBCT (Mind-fulness Based Cognitivo Therapy), nous pouvons affirmer que le risque d’expansion de l’empathie émotionnelle n’est pas un critère suffisant pour faire un burn-out, comme le prétendrait Matthieu Ricard. Ce syndrome comporte trois composantes selon Maslach, certes l’épuisement émotionnel, mais aussi la diminution de l’accomplissement et la déshumanisation au travail. Ces trois composantes devant impérativement être réunies pour en faire le diagnostic.
Nous avons démontré le pouvoir de l’empathie sur la relation thérapeutique, jusque dans le feedback sur le thérapeute lui-même. Un feedback qui le protège de toute contagion émotionnelle, voire même du burn-out. Comme avec l’hypnose, l’empathie est pourvoyeuse d’une qualité de relation, et elle peut être apaisante pour le thérapeute. Un truisme important à rappeler : le bien que l’on fait à un patient nous fait aussi du bien, rendant la relation plus efficace et plus fluide. Nonobstant le fait que l’empathie n’a résolument pas besoin d’être supplantée par la compassion, il ne faut pas pour autant mettre au rebut cette dernière. Ce serait passer à côté d’autres vertus pouvant aider le patient dans son cheminement thérapeutique, et encore une fois nous-même.
Il y a quelques années, j’ai accepté d’accompagner une éminente thérapeute et amie à une formation de TFC (Thérapie focalisée sur la compassion). Cette formation créée par Paul Gilbert, psychologue à l’université de Derby Royaume-Uni, à l’origine au profit de l’utilisation des TCC (Thérapies cognitivo-comportementales) sur des patients dépressifs résistants, était coordonnée par la psycho logue Isabelle Lebœuf, et déclinée en 8 séances de formation en groupe, lui-même constitué de thérapeutes de formations diverses. Le programme de ce type de formation vient mettre en lien des modèles cognitifs, par les trois systèmes de régulation des émotions que décrit Paul Gilbert :
* le système lié à l’instinct ;
* le système de la motivation et la recherche de la récompense ;
* le système de sécurité et d’apaisement ; ce dernier intervenant sur les deux précédents.
Pour lire la suite...
Ces descriptions étant posées , envisageons maintenant la place de l’empathie dans notre quotidien, notamment face aux menaces qu’elle rencontre, le risque de manipulation et la polémique avec la compassion.
RISQUE DE L’EMPATHIE ÉMOTIONNELLE
Par effet de mode qui détrône la résilience, notre société en vient à galvauder l’empathie. Ce mot présente certes un attrait séduisant par sa référence à un optimisme relationnel, dans un monde de paradoxe où le vivre ensemble n’est plus une priorité. Sans doute par crainte de l’avenir dans sa relation au présent difficile, l’homme se met en fragilité, en s’isolant de tout ce qui n’est pas sûr, non semblable à lui-même.
Cet état de vulnérabilité, apanage de toutes les périodes de crises, donne pouvoir à la manipulation de l’empathie qui vient se poser en apparence comme un label de bienfaisance, d’une action de fait louable, alors qu’elle ne dessert que les intérêts de l’émetteur, parfois pour le pire. L’énumération est sans limite, que ce soit dans le domaine publicitaire, politique, commercial, voire à l’extrême par des régimes totalitaires jusqu’au terrorisme. Si l’empathie cognitive est un outil pour conduire notre travail face au patient, d’autres moins bien intentionnés sont tout aussi à même de l’exploiter à des fins moins louables sur autrui, usant de sa vulnérabilité d’empathie émotionnelle.
Nous verrons un peu plus loin que c’est même une arme pour les pourfendeurs de l’empathie. Au-delà d’avoir la velléité de vouloir sauver le monde de ces impostures, le thérapeute qui a en face de lui un patient fragilisé doit se garantir que son exercice est bien adapté, et conforme à la demande ou aux besoins exprimés ; pas plus, pas moins.
DE L’EMPATHIE À LA COMPASSION
Abordons maintenant la compassion qui vient atteindre notre empathie jusque dans son identité. Pour certains en effet, cette dernière doit être mise au rebut, car elle conduit inévitablement le porteur d’empathie à un burn-out ; et cela en raison d’un risque de contagion émotionnelle majeure. Matthieu Ricard, dans son livre Plaidoyer pour l’altruisme, affirme qu’il est nécessaire d’imprégner l’empathie de compassion, voire la substituer, précisément pour les soignants, afin de leur permettre de garder une distance en termes d’émotions. Cette compassion empêche que la résonance affective dans son amplification ne vienne paralyser le soignant et engendrer un épuisement émotionnel conduisant à un burn-out inévitable. Remplie d’amour altruiste, la compassion est pour lui le seul antidote possible.
Nous reviendrons plus loin sur sa conception du burn-out un peu réductrice. Mais de façon étonnante, Matthieu Ricard, comme d’autres, réduit l’empathie à l’empathie affective (ou émotionnelle) à laquelle il oppose la compassion qui, elle seule, se situe dans une démarche rigoureusement active. Pour appuyer sa théorie, il s’associe à la psychologue Tania Singer, directrice de l’Institut des neurosciences sociales Max Planck à Leipzig, qui prétend qu’on ne peut utiliser les mêmes termes d’empathie pour une partie affective et cognitive, car elle concerne deux zones différentes du cerveau. Ces théories sont reprises par d’autres neuroscientifiques et psychologues des USA à la Suisse.
Se reposant sur les menaces que nous venons d’aborder, le psychologue Paul Bloom (université de Yale), dans son livre Against Empathy : The Case for Rational Compassion en 2016, affirme son opposition à l’empathie qu’il qualifie de « ressenti comme », et qui conduit à prendre de mauvaises décisions, pouvant même nous entraîner dans des formes de cruauté. Pour étayer ses dires, il cite de nombreux exemples, où la barbarie s’invente des bonnes raisons, notamment l’Allemagne des années 1930 avec les attaques antisémites, et plus actuellement le président des USA qui par des manœuvres d’empathie à l’égard de la classe moyenne « qu’il comprend », a largement activé l’hostilité contre les réfugiés, offrant des récits des « pauvres victimes » qui en ont subi les actions. Sans prendre la peine de séparer le bon du mauvais, et en jetant tout de l’empathie, Paul Bloom ajoute que l’avantage de la compassion est qu’elle n’a pas besoin d’éprouver la souffrance de l’autre puisqu’elle est dans l’action. Pour lui, comme pour beaucoup, elle seule est dans le « care ». Il ne s’adresse donc pas aux soignants, qui eux, sont déjà dans le « care » !
Comment sortir de cette opposition que Serge Tisseron résume très bien ainsi : d’un côté, ceux qui prônent la compassion comme la transformation de l’empathie sous forme d’action, devenant ainsi un mode de prévention du burn-out. De l’autre, le psychologue Charles Figley, directeur de l’université de Tulane en Louisiane et spécialiste du trauma, affirme que la compassion mène au burn-out et que seule l’empathie cognitive peut l’éviter.
COMPASSION ET CULTURE
Au-delà de servir une querelle de clochers probable, il existe une différence sémantique entre les termes « empathie » et « compassion ». Notons qu’il existe également plusieurs connotations du terme compassion.
Dans la tradition chrétienne, le mot compassion signifie « souffrir avec... », la passion évoquant la souffrance, en référence à la passion du Christ. Dans la tradition bouddhiste, le mot empathie n’existe pas, et le mot compassion a une tout autre signification. Il est important d’aborder cette question de la signification de la compassion dans le bouddhisme puisque la majorité des détracteurs de l’empathie ont un discours d’inspiration bouddhiste, souvent en rapport à une pratique associée.
Pour saisir le sens de leur argumentaire, il faut acquérir quelques connaissances sur cette tradition. Le bouddhisme, qui est aussi une philosophie de vie, allie le respect, la compassion, la pensée de l’autre, mais plus encore au travers des Quatre nobles vérités, prône l’inévitabilité de la souffrance et le chemin d’éveil pour en sortir. La compassion, constituant de ce chemin, est une « claire » acceptation des autres comme de soi-même, avec cette capacité d’être avec l’autre, dans son bonheur et son chagrin, avec amour et partage. La « clarté », par opposition à la confusion génératrice de nombre de maux, est acquise au décours de la pratique de la méditation bouddhiste. Finalement la compassion est à la tradition bouddhiste ce qu’est la miséricorde aux traditions abrahamiques (« une vertu du cœur compatissant qui partage la misère d’autrui afin de la secourir »).
Dans toutes ces traditions spirituelles, la compassion trouve sa véritable expression sur le précepte de ne pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fasse ; elle se positionne dans une connivence entre une instance supérieure et les hommes qui en dépendent. De même dans la culture africaine, l’« Ubuntu », issu de la culture bantou, valorise aussi la compassion, associée au « vivre ensemble », à l’interdépendance des individus dans la communauté et à la dignité de chacun. Il importe de comprendre que les discours et les traditions différentes trouvent leur unité dans ce que Régis Debray appelait si bien « la laïcité de la connaissance ». Faut-il rejeter la compassion en raison de sa référence bouddhiste ? Certainement pas ! Rappelons que la « mindfulness », par sa laïcisation de la méditation bouddhiste, a été un apport considérable dans les TCC de troisième vague basées sur les émotions (3). Cette pratique laïque continue son œuvre dans la gestion des émotions : un effet thérapeutique indéniable et validé s cientifiquement, un apport pour le thérapeute, quelle que soit sa pratique.
APPROCHE CLINIQUE
Dès 2020, nous avons organisé des groupes de prévention du burn-out dans un service d’urgence, particulièrement contraignant en termes de pénibilité, en associant la mindfulness et l’hypnose, ainsi que les théories de Paul Watzlawick sur la communication humaine, tout en abordant les démarches d’empathie émotionnelle et cognitive. Ces dernières amènent ces soignants à beaucoup plus de distance face au stress perçu et transmis par les patients. La poursuite de notre travail avec des groupes MBI (Mindfulness Based Intervention) au profit de soignants d’autres services, s’est avérée très porteuse en termes de gestion émotionnelle.
Après un travail longitudinal de deux années sur la prise en charge du burn-out par le MBCT (Mind-fulness Based Cognitivo Therapy), nous pouvons affirmer que le risque d’expansion de l’empathie émotionnelle n’est pas un critère suffisant pour faire un burn-out, comme le prétendrait Matthieu Ricard. Ce syndrome comporte trois composantes selon Maslach, certes l’épuisement émotionnel, mais aussi la diminution de l’accomplissement et la déshumanisation au travail. Ces trois composantes devant impérativement être réunies pour en faire le diagnostic.
Nous avons démontré le pouvoir de l’empathie sur la relation thérapeutique, jusque dans le feedback sur le thérapeute lui-même. Un feedback qui le protège de toute contagion émotionnelle, voire même du burn-out. Comme avec l’hypnose, l’empathie est pourvoyeuse d’une qualité de relation, et elle peut être apaisante pour le thérapeute. Un truisme important à rappeler : le bien que l’on fait à un patient nous fait aussi du bien, rendant la relation plus efficace et plus fluide. Nonobstant le fait que l’empathie n’a résolument pas besoin d’être supplantée par la compassion, il ne faut pas pour autant mettre au rebut cette dernière. Ce serait passer à côté d’autres vertus pouvant aider le patient dans son cheminement thérapeutique, et encore une fois nous-même.
Il y a quelques années, j’ai accepté d’accompagner une éminente thérapeute et amie à une formation de TFC (Thérapie focalisée sur la compassion). Cette formation créée par Paul Gilbert, psychologue à l’université de Derby Royaume-Uni, à l’origine au profit de l’utilisation des TCC (Thérapies cognitivo-comportementales) sur des patients dépressifs résistants, était coordonnée par la psycho logue Isabelle Lebœuf, et déclinée en 8 séances de formation en groupe, lui-même constitué de thérapeutes de formations diverses. Le programme de ce type de formation vient mettre en lien des modèles cognitifs, par les trois systèmes de régulation des émotions que décrit Paul Gilbert :
* le système lié à l’instinct ;
* le système de la motivation et la recherche de la récompense ;
* le système de sécurité et d’apaisement ; ce dernier intervenant sur les deux précédents.
Pour lire la suite...
Dr Olivier de Palézieux
Praticien hospitalier en médecine d’urgence. Chef de service à l’EPS Barthélemy-Durand Centre régional de la douleur à Etampes (Essonne). Psychothérapeute certifié AFTCC, Access MBCT et ACT. Praticien en Hypnose médicale et enseignant de Mindfulness à l’université Toulouse III.
N°77 : Mai / Juin / Juillet 2025
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce numéro :
Editorial : « L’empathie et la compassion comme fil d’or du soin » Julien Betbèze
8 / En couverture : Anne Dayot De sable et d’algues Sophie Cohen
10 / Désamorcer les traumas et se replacer dans l’existence par la Psychothérapie du Trauma Réassociative (PTR) Marine Manouvrier et Gérald Brassine
20 / Chemsex, trauma et EMDR-IMO . L’échelle de mesure « croire en moi » Sophie Tournouër
28 / Cothérapie avec Romain Faire émerger les relations sécures Jérémie Roos
36 / La voie métaphorique en « super-inter-vision ». Comment développer la créativité. des soignants Claire Conte-Rossin et Catherine Martin
ESPACE DOULEUR DOUCEUR
46 / Introduction Gérard Ostermann
50 / Empathie et compassion Deux forces pour soigner autrement Olivier de Palézieux
61 / INTERVIEW Mylène Blasco Propos recueillis par Gérard Ostermann
68 / DOSSIER TOC
70 / La société contemporaine : Perfection et fabrique des TOC Grégoire Vitry et Emmanuelle Gallin
82 / La pensée magique dans les TOC Typologie des rituels magiques Claude Michel
QUIPROQUO
98 / Les obsessions S. Colombo, Muhuc
BONJOUR ET APRÈS...
102 / André et son ventre Pour une séance plus qu’émouvante Sophie Cohen
LES CHAMPS DU POSSIBLE
106 / Se cogner au réel Adrian Chaboche
CULTURE MONDE
114 / Dans les sanctuaires du shintō Bruno Bréchemier
LIVRES EN BOUCHE
120 / J. Betbèze et S. Cohen
125 ESPACE FORMATIONS
Illustrations: Anne DAYOT
-
 André et son ventre. Revue Hypnose et Thérapies brèves n°77
André et son ventre. Revue Hypnose et Thérapies brèves n°77
-
 Jeanne, psychologue et sa peur de tomber dans un abîme. Revue Hypnose et Thérapies Brèves 76.
Jeanne, psychologue et sa peur de tomber dans un abîme. Revue Hypnose et Thérapies Brèves 76.
-
 CHRISTELLE et la trichotillomanie en question.
CHRISTELLE et la trichotillomanie en question.
-
 SANDRINE se sent très triste...Revue Hypnose & Thérapies Brèves 74.
SANDRINE se sent très triste...Revue Hypnose & Thérapies Brèves 74.
-
 Hélène et les femmes malheureuses en couple. Revue hypnose et thérapies brèves 73.
Hélène et les femmes malheureuses en couple. Revue hypnose et thérapies brèves 73.








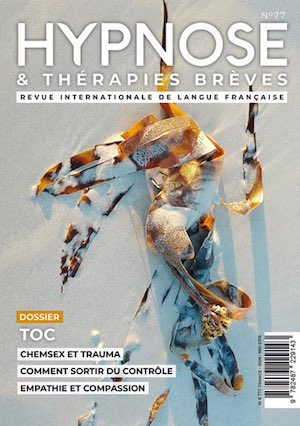


 André et son ventre. Revue Hypnose et Thérapies brèves n°77
André et son ventre. Revue Hypnose et Thérapies brèves n°77



